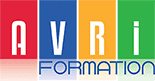Toujours dans la série sur le cerveau ouverte dans ce numéro de Futuribles, Pascale Toscani pose, en introduction à son texte, une question qui nous est familière : pourquoi faut-il réfléchir avant de répondre à une question qui nous est posée ? Parce que, explique-t-elle, « notre cerveau travaille avant nous, avant que l’information n’arrive à notre conscience », qu’il est doué d’une capacité d’anticipation qui repose sur tout ce qu’il a enregistré dans le passé. Mais fouiller dans notre mémoire ne suffit pas et l’auteur nous montre l’inadéquation fréquente entre la question et la réponse selon les termes employés, les représentations de chacun, nos référents culturels…
À l’aide de nombreux exemples, l’auteur nous alerte sur nos biais cognitifs, une organisation de pensée trompeuse et faussement logique dont elle entend exposer quelques-unes des raisons explicatives. D’abord en précisant comment est organisé et fonctionne le cerveau des bébés, puis comment opèrent les apprentissages scolaires. Ensuite en reprenant, pour les approfondir, les deux systèmes de pensée mis en avant par Daniel Kahneman (la pensée automatique fondée sur la « mémoire procédurale » vs l’activité mentale, réflective et exigeante), afin de montrer le rôle essentiel que joue l’intelligence pour nous affranchir des idées reçues, des biais cognitifs et gérer les situations marquées par des « dissonances cognitives ».
H.J. ■
Nos grands-mères (et très certainement nos grands-pères aussi…) nous conseillaient, par cette sage formule, de tourner notre langue sept fois dans notre bouche avant de répondre à une question, afin d’éviter de regretter la réponse. Avaient-elles l’intuition du sens des biais cognitifs avant que les sciences cognitives ne les conceptualisent ?
Les recherches en sciences cognitives sont suffisamment documentées aujourd’hui pour confirmer l’hypothèse selon laquelle notre cerveau travaille avant nous, c’est- à-dire avant que l’information n’arrive à notre conscience. Ce processus de fonctionnement par anticipation s’appuie en fait sur l’organisation cérébrale de notre mémoire. C’est en effet parce nous avons appris, souvent par la répétition, mais aussi par réflexe, par imitation, que notre cerveau est capable de prévoir ce qui peut advenir ou de formuler des hypothèses sur ce qui est susceptible d’arriver. Nos neurones ne cessent de créer des ponts entre notre passé et notre futur, entre ce que nous avons vécu, appris et ce que nous pouvons projeter de ces expériences et connaissances sur le présent et vers l’avenir. Entre ce qui est plausible, prévisible ou hypothétique, entre ce qui est conscient et ce qui se joue à notre insu, s’ouvre un vaste espace de combinatoires dans lequel voyage notre cerveau pour traiter les informations et envisager des réponses.
Ce processus représente tout à la fois une richesse et une limite cognitive. Une richesse lorsque le cerveau se révèle capable de réaliser, extrêmement rapidement, une synthèse très élaborée pour formuler une réponse ; une limite dans la mesure où la réponse formulée peut être inadéquate. Une inadéquation qui se décline en différences entre celui qui pose la question et celui qui fournit une réponse : différence de représentations, différence de référents culturels ou encore de façons de traiter les informations. Répondre à une question (que ce soit de manière impulsive ou réflexive) engage le système cognitif, social et psychologique de chaque être humain.
Finalement, tourner sept fois sa langue dans sa bouche est-il suffisant ? Faudrait-il s’obliger à un long silence réflexif avant de formuler une réponse à une question ? Quand bien même nous en passerions par là, cela empêcherait-il notre cerveau de produire une pensée qui vient du fond de notre inconscient (psychologique et / ou inconscient) et qui traite l’information avant même que nous en ayons conscience ?
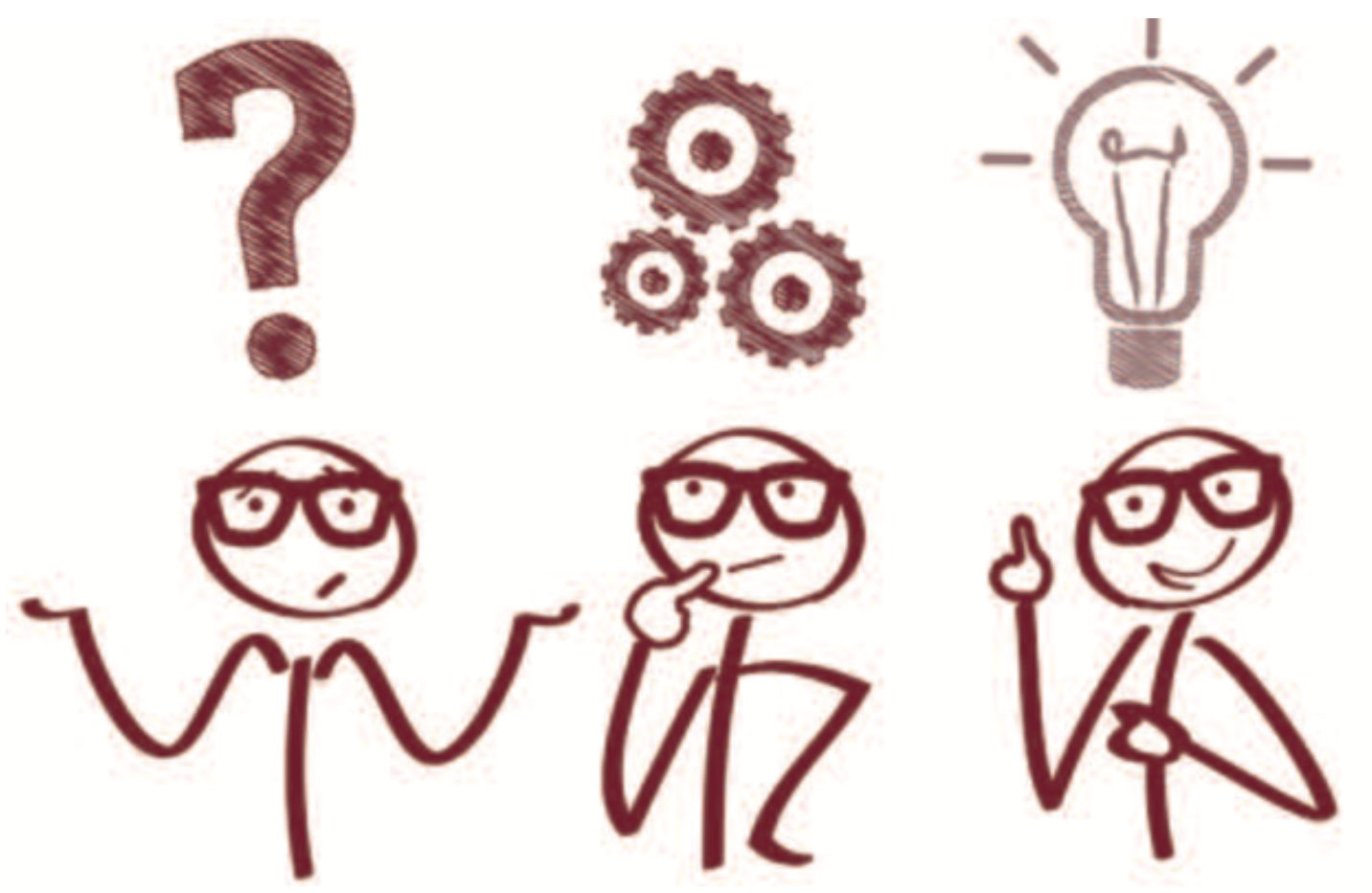
Aucune pédagogie, aucune intelligence artificielle, aucune machine ne peut encore décrypter, et cela est sans doute une bonne chose, l’évolution de l’organisation cognitive de chacun des humains depuis leur embryogenèse, pour expliquer la production d’une réponse. Les neurones dialoguent entre eux, dans un langage que l’on appelle le code neural. Ainsi, le cerveau traduit les informations recueillies par notre environnement que nous nous chargeons de comprendre, d’interpréter. De fait, sans que nous en prenions conscience, dès lors que ces informations recueillies sont contradictoires, nous pouvons nous engager dans des processus de résistance pour lutter contre la remise en cause de certaines certitudes, ou habitudes de pensée. Retranchés parfois derrière une certaine rigidité cognitive, nous pouvons même développer une forme de cécité face à de nouvelles informations. De façon plus subtile, notre cerveau peut opérer un tri et ne prendre en considération que les informations conformes à nos croyances, c’est-à-dire à notre vision du monde, même si celle-ci est totalement erronée. En dernier recours, il lui reste la possibilité de nier le problème.
Aucune pédagogie, aucune intelligence artificielle, aucune machine ne peut encore décrypter, et cela est sans doute une bonne chose, l’évolution de l’organisation cognitive de chacun des humains depuis leur embryogenèse, pour expliquer la production d’une réponse. Les neurones dialoguent entre eux, dans un langage que l’on appelle le code neural. Ainsi, le cerveau traduit les informations recueillies par notre environnement que nous nous chargeons de comprendre, d’interpréter. De fait, sans que nous en prenions conscience, dès lors que ces informations recueillies sont contradictoires, nous pouvons nous engager dans des processus de résistance pour lutter contre la remise en cause de certaines certitudes, ou habitudes de pensée. Retranchés parfois derrière une certaine rigidité cognitive, nous pouvons même développer une forme de cécité face à de nouvelles informations. De façon plus subtile, notre cerveau peut opérer un tri et ne prendre en considération que les informations conformes à nos croyances, c’est-à-dire à notre vision du monde, même si celle-ci est totalement erronée. En dernier recours, il lui reste la possibilité de nier le problème.
Qu’est-ce qu’un biais cognitif ?
Je vous invite à faire un détour par un exemple, en partant d’une question simple, mais qui nourrit des controverses depuis plusieurs décennies : « Pensez-vous que l’École soit une institution qui favorise l’égalité des chances ? »
Votre réponse sera différente selon votre parcours scolaire, plus ou moins erratique, selon le niveau de formation que vous avez atteint, selon votre profession actuelle. Cette réponse sera militante si vous êtes un défenseur de l’École de la République, engagée si vous avez des convictions concernant l’égalité ou l’inégalité entre êtres humains, peut-être évasive si vous ne vous êtes jamais posé la question. La variété des réponses sera donc liée à l’histoire et la formation de chacun d’entre vous.
Pour aller plus loin et engager autrement la réflexion, il suffirait de formuler la question ainsi : « Pourquoi pense-t-on que l’École favorise l’égalité des chances ? » Cette version vous obligerait alors à faire un pas de côté, à vous décentrer par rapport à vous-même pour vous engager dans une réflexion moins spontanée, beaucoup plus approfondie. Vous feriez appel à vos multiples références, conscientes ou non, pour étayer votre réponse. La caméra de votre réflexion intérieure pourrait zoomer en priorité sur le concept philosophique d’égalité en conflit avec celui d’équité. Elle pourrait zoomer sur les finalités de l’École, ou faire un travelling sociologique sur la pertinence des études de Pierre Bourdieu qui restent tout à fait d’actualité. Elle pourrait choisir de faire un gros plan sur la responsabilité des enseignants ou une vue en contre-plongée sur l’univers des réformes.
La couleur des réponses aurait été encore différente, et sans doute beaucoup plus sombre, si j’avais glissé une négation dans la formulation : « Pourquoi pense-t-on que l’École ne favorise pas l’égalité des chances ? »
Sommes-nous finalement capables de regarder le monde autrement que par le prisme de notre propre subjectivité ? Ce qui laisserait d’ailleurs penser que l’objectivité n’existe pas. Sommes-nous condamnés à considérer nos pensées comme des mirages à partir du moment où nous acceptons l’idée que nous organisons le monde, non pas tel qu’il est, mais tel que nous avons envie de le décrire…, pour terminer par le voir ? Si l’interprétation du réel se fonde en fait sur des croyances, des postulats, des théories qui orientent nos pensées et nous procurent un point de vue particulier sur le monde, peut-on néanmoins apprendre à penser comme si nous n’étions pas vraiment « soi » ?
Ce long détour, émaillé d’exemples, de questions et de réponses possibles cherche à tracer une limite entre la perception individuelle du monde constitutive de notre identité d’un côté, et les erreurs de raisonnement imputables à notre fonctionnement cognitif de l’autre, comme si notre cerveau partait en biais. En fait, plus nous avançons dans la connaissance du fonctionnement du cerveau, plus cette limite s’estompe. Ce que nous regardions comme un défaut à corriger ne se rapproche-t-il pas de ce qui fait la nature même du fonctionnement du cerveau et non la marque de ses dysfonctionnements ? Déjà au milieu des années 1950, le psychosociologue américain Leon Festinger avait mené des recherches dans cette direction et rendait compte de ses observations dans un ouvrage paru en 1957 présentant sa « théorie de la dissonance cognitive1Festinger Leon, A Theory of Cognitive Dissonance, Palo Alto : Stanford University Press, 2009 (1re éd., 1957). ». Il expliquait notamment comment le système cognitif s’adapte, voire se modifie pour atténuer les tensions internes entre individus ou groupes d’individus lorsqu’il y a conflit de pensées, de croyances ou d’émotions. Dans les années 1970, Daniel Kahneman et Amos Tversky2Kahneman Daniel et Tversky Amos, « Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability », Cognitive Psychology, vol. 5, n° 2, septembre 1973, p. 207-232. dressent un inventaire des situations où notre cerveau est susceptible de suivre des raisonnements tout à fait irrationnels dans le domaine économique. Ces erreurs systématiques qui affectent nos rai- sonnements adultes prennent le nom de « biais cognitifs ».
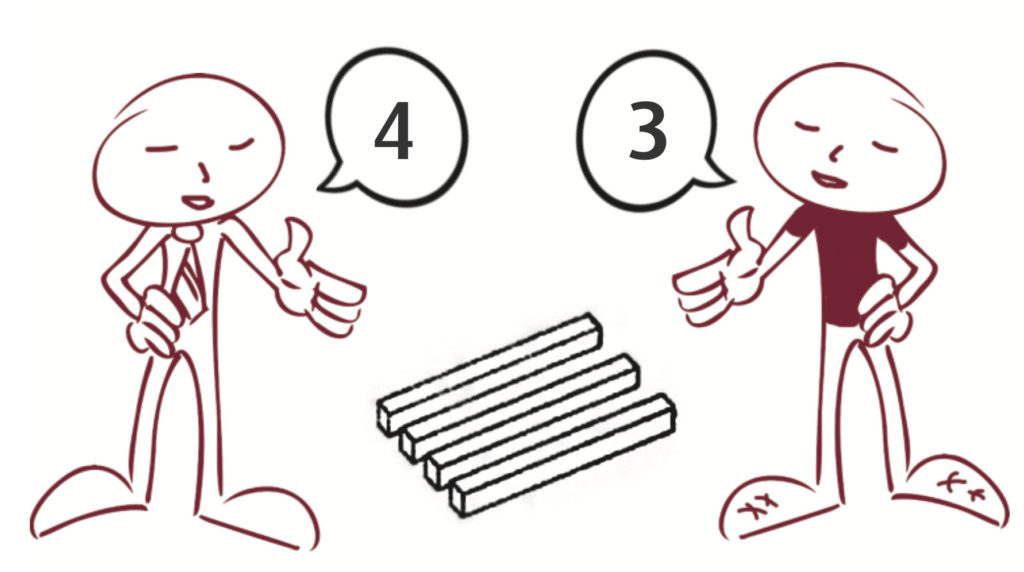
Nous appelons un biais cognitif une organisation de pensée trompeuse et faussement logique, dont la personne s’accommode pour prendre position, justifier des déci- sions, ou encore interpréter les événements. Dans son dernier ouvrage, Le Syndrome de l’autruche. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique3Marshall George, Le Syndrome de l’autruche. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique, Arles : Actes Sud (Domaine du possible), 2017 (traduction de Don’t Even Think about It: Why our Brains are Wired to Ignore Climate Change, New York : Bloomsbury, 2014)., le sociologue américain George Marshall illustre tout à fait ce que nous cherchons à définir en termes de biais cognitif. Après avoir posé la question : « Croyez- vous que le changement climatique influencera l’avenir de la planète ? », l’auteur recueille une incroyable quantité de réponses différentes et contradictoires, que ce soit dans le monde politique, scientifique, ou celui de tout un chacun à travers les réseaux sociaux. Certains nient totalement le problème tandis que d’autres reconnaissent les modifications climatiques sans prendre la moindre décision de changement. La représentation du concept de biais cognitif évoque donc un arrière-goût de distorsion, de paradoxe, de pensée irrationnelle, ou encore de jugement erroné. Y aurait-il donc une pensée exempte de biais cognitif qui aurait le mérite d’être rationnelle, sans ambiguïté, juste, incontestable, exacte ?
Léon Festinger et la théorie de la dissonance cognitive
Pour justifier leurs conduites ou leurs raisonnements, les humains s’appuient sur des références qu’ils considèrent comme logiques, pour diverses raisons : parce qu’elles semblent avoir fait leurs preuves par exemple, parce qu’elles étaient tenues pour vraies dans des situations antérieures, ou encore parce qu’elles sont affirmées par les médias… Mais ces raisonnements accommodants, qui permettent de maintenir un équilibre intérieur entre soi et la représentation du monde, se trouvent fragilisés s’ils provoquent « un sentiment d’inconfort psychologique ». « Inconfort causé par deux éléments cognitifs discordants, et plongeant l’individu dans un état qui le motive à réduire ce sentiment inconfortable.4FESTINGER Leon, A Theory of Cognitive Dissonance, Palo Alto : Stanford University Press, 2009 (1re éd., 1957). »
Un exemple pour illustrer le concept : certains éducateurs restent persuadés de la fixité du fonctionnement cognitif alors même que le concept de plasticité cérébrale fait consensus dans la communauté neuroscientifique internationale.
Il est encore fréquent d’entendre, dans les conseils de classe, des propos tels que : « cet enfant a atteint ses limites, il ne peut faire plus ; il n’a pas l’intelligence pour faire telle chose ; il manque de compétences intellectuelles… » Accepter la plasticité cérébrale et le développement des capacités cognitives des élèves renverraient ces éducateurs vers une remise en cause de leur conception de l’apprentissage et de la réussite. Ils préfèrent alors s’abriter derrière des exemples qu’ils érigent en contre-preuve, persuadés que les chercheurs ne sont jamais sortis de leur laboratoire pour voir de « vrais élèves ». Cette sur-généralisation leur permet ainsi d’échapper à la dissonance cognitive à laquelle il faudrait se confronter.
P.T.
Le rôle du cerveau dans ce processus
Flashback sur l’organisation du cerveau du bébé, qui commence déjà à produire de la pensée, des hypothèses et des prédictions. Le cerveau du nourrisson est un puissant radar qui capte tous les signaux de son environnement. À sa naissance, son cerveau n’est pas une boîte vide à remplir. Il ne naît pas tabula rasa, il est déjà structuré pour traiter l’information et capable de bien des compétences. Il possède par exemple l’intuition du nombre et de la proportionnalité. Son cerveau sera capable d’apprendre rapidement sa langue maternelle, de reconnaître les objets, les visages, capable d’émettre des hypothèses, capable d’inférence et d’anticipation. Dès trois mois, le cerveau de l’enfant peut détecter le sens des symboles, et même comprendre qu’il s’est trompé ! En d’autres termes, il apprend déjà de ses propres expériences !
Durant l’enfance, l’architecture du cerveau se modifie en fonction de l’expérience et de l’apprentissage ; ainsi, et même si tous les enfants apprennent globalement la même chose au même âge, ils ne se développent pas de manière identique, comme des machines à apprendre qui le feraient hors contexte, ou comme si les cerveaux des enfants étaient tous clonés. Chaque bébé capte une très grande quantité d’informations que son cerveau traite ou inhibe, en fonction de son évolution dans le contexte de vie qui est le sien. Riche de cette puissante organisation cérébrale, l’enfant évoluera dans un monde déjà structuré par sa culture, ses habitudes, ses coutumes, sa logique de pensée et d’action, sa langue ou ses langues, sa manière d’appréhender le réel… Autant de signaux que le cerveau de l’enfant va filtrer et interpréter. Chaque cerveau va ainsi mettre en œuvre des processus sélectifs futurs en fonction de ce qu’il a déjà décodé. Cette sélection donne cohérence à la perception du monde et à l’organisation de la pensée. Mais cette cohérence interne est fragile, elle peut être mise en danger. Pour ne pas rigidifier ses angles de vue, il est donc important de trouver, sur le chemin de sa vie, des informations contradictoires aux représentations établies, mais surtout d’être accompagné pour les interroger et les reconsidérer. C’est là un des rôles des accompagnateurs des enfants qui, à partir de leurs perceptions contradictoires, les engageront à développer leur sens critique.
L’approche scientifique elle-même n’est pas exempte de regards contradictoires qui la traversent et la définissent. Ainsi, par exemple, pendant de longues années, se sont opposées les positions scientifiques innéistes et les positions scientifiques empiriques. Les uns pensaient que le cerveau était totalement déterminé génétiquement, et les autres pensaient au contraire qu’il était façonné essentiellement par l’environnement. On sait aujourd’hui que les uns et les autres avaient raison, ensemble. La question de l’intelligence ne faisait pas vraiment débat avant le XXe siècle, tant il semblait évident qu’elle était héréditaire et génétiquement programmée. Aujourd’hui encore, Il y a autant de généticiens qui soutiennent cette thèse que de généticiens qui affirment le contraire. Question de paradigme scientifique…, qui implique un angle de vision, un choix de paramètres à privilégier. Il est donc probablement impossible de définir l’intelligence, sinon sur des caractéristiques subjectives et ambiguës, même si elles semblent scientifiques, mais chacun de nous aborde la question de l’intelligence avec ses propres certitudes.
Du cerveau à l’apprentissage
Qu’en est-il des apprentissages scolaires qui participent à cette éla- boration cérébrale ? Les enfants et les jeunes gens, qu’ils soient élèves ou étudiants, sont confrontés aux savoirs scientifiques et, donc, aux réajustements permanents de ces savoirs en fonction des progrès de la science et des évolutions de la société. Mais ils sont aussi dépendants des mécanismes cérébraux internes qui se mettent en place lors de tout apprentissage. Ce que Jean-Pierre Astolfi5Astolfi Jean-Pierre et Peterfalvi Brigitte, « Obstacles et construction de situations didactiques en sciences expérimentales », Aster, n° 16 / Modèles pédagogiques 1, 1993, p. 103-141. appelait des obstacles épistémologiques : « L’idée d’obstacle entretient évidemment des relations avec celle de représentations et de conceptions des élèves, mais on peut la décrire comme plus forte. Ce n’est pas seulement que les élèves pensent différemment et que l’on peut identifier leur logique cognitive, c’est qu’il existe une certaine nécessité au maintien de ce système de pensée. On peut dire que l’obstacle présente un caractère plus général et plus transversal que la représentation : il est ce qui, en profondeur, l’explique et la stabilise. Diverses représentations, qui portent sur des notions sans lien apparent, peuvent en effet apparaître, à l’analyse, comme les points d’émergence d’un même obstacle. » L’obstacle épistémologique permet de produire des réponses adaptées à certains problèmes, mais il conduit à des réponses erronées dans d’autres types d’apprentissage, notamment lorsque s’exercent des forces de résistance à toute modification ou transformation de ses représentations. En fait, comprendre pourquoi nous résistons à certains éléments d’une connaissance aboutit paradoxalement à une connaissance enrichie et consolidée. L’erreur de raisonnement comprise nous permet alors de franchir l’obstacle épistémologique.
Dans son ouvrage Système 1 / système 2, Daniel Kahneman6Kahneman Daniel, Système 1 / système 2. Les deux vitesses de la pensée, Paris : Flammarion, 2012 (traduction de Thinking, Fast and Slow, New York : Farrar, Straus and Giroux, 2011, analysé in Futuribles, n° 390, novembre 2012, p. 25-34 [NDLR]). propose un autre éclairage sur les obstacles que nous rencontrons dans notre façon de traiter l’information et d’apprendre. Notre cerveau recèlerait deux systèmes de pensée. Le système 1 fonctionnerait automatiquement et rapidement, avec peu ou pas d’effort et sans contrôle délibéré. Relié à la mémoire procédurale (la mémoire des automatismes), le rappel de l’information serait automatique mais comporterait son lot d’erreurs d’encodage et d’erreurs épistémologiques. Le système 2 accorderait en revanche de l’attention aux activités mentales contraignantes. Il nécessiterait de l’attention, de la vigilance, il questionnerait, remettrait en doute, réaliserait et vérifierait des hypothèses. Notre cerveau ne l’utiliserait pas en priorité parce qu’il est coûteux en énergie. Mais alors, apprenons donc aux élèves à favoriser le système 2, allez- vous suggérer ! Pas si simple dans la logique d’enseignement. Les travaux d’Olivier Houdé7Houdé Olivier, Apprendre à résister. Pour l’école, contre la terreur, Paris : Le Pommier, 2017 (nouvelle édition augmentée, 1re éd., 2014). s’orientent vers cette application didactique dans la salle de classe, en favorisant ce qu’il nomme le système 3, un système d’inhibition aux automatismes intuitifs.
L’itinéraire que nous venons de suivre nous a fait traverser des champs disciplinaires relativement différents : les neurosciences, la psychologie, la sociologie, l’économie et les sciences de l’éducation. Au- tant dire que les sciences cognitives ont tout intérêt à envisager leur développement en lien avec d’autres domaines de connaissances, dans une démarche basée sur la complexité, chère à Edgar Morin. S’appuyer par exemple sur l’inhibition cognitive paraît indispensable, mais insuffisant pour régler définitivement les problèmes posés par les biais cognitifs qui, d’une certaine façon, participent à l’identité de chacun, à la culture, à l’évolution sociétale et à la sauvegarde de son moi… Il est vraisemblablement impossible de s’affranchir des biais cognitifs, que l’on soit jeune apprenant ou adulte, ce qui ne veut pas dire que nous devions rester sans réaction par rapport à leurs effets, au contraire.
Toute éducation doit prendre le chemin de la maîtrise de notre propre fonctionnement pour nous guider vers notre émancipation et notre liberté de penser. Mais apprendre va de pair avec une autre réalité : désapprendre… Les acteurs de l’École ont un rôle à jouer pour que le système éducatif prenne des distances avec ses propres rigidités et s’engage dans ce sens. Comment demander à des élèves d’apprendre à réfléchir, à prendre du recul, alors qu’ils passent la majeure partie de leur vie scolaire à intégrer des informations et à devoir répondre à des questions qu’ils ne se sont jamais posées ? Ce processus d’accès aux informations favorise les erreurs didactiques et les biais cognitifs. L’apprentissage n’est pas un empilement de connaissances, c’est une réorganisation permanente de connaissances à partir d’hypothèses validées et / ou invalidées. Un cerveau passif n’apprend pas, nous rappelle Stanislas Dehaene8Dehaene Stanislas, Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines, Paris : Odile Jacob, 2018.. Être actif en apprentissage suppose, entre autres, d’être questionneur. L’élève qui pose une question a une intuition sur le bout de la langue. Il faut la saisir parce qu’elle est sans aucun doute l’élément principal de cette richesse cognitive à l’origine de la modification de ses représentations : un exercice cognitif qui permettra de prendre conscience qu’il existe une association non consciente entre ce que nous impose le réel et ce que nous projetons sur lui pour le comprendre. Ce qui veut dire que tout apprentissage est l’intrication complexe entre une connaissance qui peut être universelle et une compréhension qui sera de nature idiosyncrasique.
Le cerveau pourra se contenter de flirter avec la simplicité cognitive si l’École s’acharne à transmettre des savoirs sans se soucier des mécanismes et des processus à l’origine de tout apprentissage. L’École serait alors dans la même logique que celle d’un médecin qui déciderait de soigner tous les maux de gorge avec le même protocole, sans se soucier du diagnostic et de l’évolution des symptômes. Connaître et comprendre le mécanisme des biais cognitifs est en fait une ressource puissante pour enseigner et apprendre. Ce qui engage à faire dialoguer les chercheurs en neurosciences avec les décideurs et les acteurs du monde de l’éducation.
Cet article a été publié dans la revue Futuribles n°428